Marie-Madeleine et le Hiéros Gamos
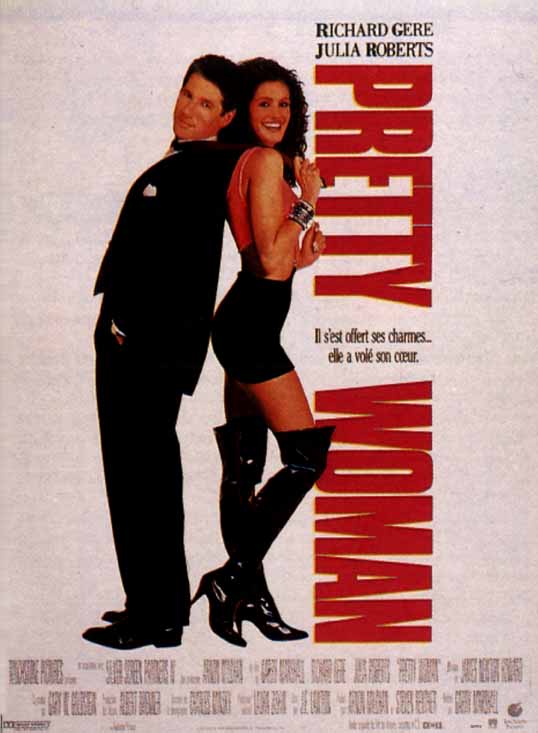 De toute évidence,
Marie-Madeleine est l'héroïne principale du Da Vinci Code.
Indirectement, bien sûr et c'est néanmoins bien le cas. Tout s'articule autour de quelques questions que l'on se pose à son propos et qui sont de nature à aboutir au
dénouement de l'énigme, la découverte des secrets et des trésors, et peut-être plus encore. Ces questions les voici : Marie-Madeleine était-elle bien la prostituée que nous
montrent les évangiles ? Était-elle la prêtresse d'une autre divinité ? Était-elle la concubine de Jésus, sa femme, lui donna t'elle un enfant (plusieurs ?), Jésus est-il
bien mort sur la croix et a t'il seulement existé ?
Marie-Madeleine a t'elle réellement existé ou s'agit-il aussi d'un mythe ? Est-elle venue en France, et si oui, pourquoi et comment ? Quel est le rapport entre elle et le
dieu-soleil ? Entre elle et l'affaire de Rennes-le-château, entre elle et les Templiers, etc. Autant de questions auxquelles nous allons tenter de répondre car nous
avons besoin de ce savoir afin de démêler d'autres énigmes.
Marie-Madeleine était-elle une prostituée ?
En dépit de ce que nous disent les évangiles à son sujet, non ! En dépit des apparences et de ce que l'on peut voir dans
les nombreuses représentations artistiques qui la concernent, Marie-Madeleine n'était pas une prostituée au sens où nous l'entendons et l'Église a d'ailleurs revu son
jugement à son propos en 1969 dans son encyclique de l'Église catholique romaine où elle révoque l'épithète non fondé et calomnieux de "prostituée" en stipulant qu'aucun
témoignage biblique ne pouvait attester de cette tradition apocryphe.
Marie-Madeleine était-elle une femme de petite vertu ?
Il est bon de préciser ici la différence. Dans notre entendement l'un n'implique pas forcément l'autre, une prostituée faisant commerce de son corps, une femme de petite vertu aurait des aventures plus ou moins nombreuses et/ou adultérines ou encore des activités parallèles de nature sexuelle sans qu'il ne soit forcément question de rétribution.
Or, en voyant les choses sous cet angle, il y a moyen de se poser des questions. Marie-Madeleine, d'après certaines sources, aurait pu participer régulièrement au rituel du
Hiéros gamos (voir plus loin), on aurait aussi pu la confondre avec la femme adultère des écritures, que la vindicte populaire s'apprêtait à lapider et qui fut
sauvée in extremis par une phrase célèbre de Jésus : "Que celui qui n'a jamais péché lui jette la première pierre". Par ailleurs, la situation se complique lorsque l'on sait
que l'époque et le contexte acceptait la polygamie (ou du moins la bigamie), que les rabbins se devaient d'être mariés pour pouvoir exercer (c'était donc théoriquement aussi le cas pour Jésus dont le qualificatif de rabbin convient puisqu'il fut plusieurs fois appelé "Rabbi") et enfin que l'on admettait des unions de type marital et spirituel. Après cela, que la confusion ait pu régner, que les témoignages aient pu être déformés au fil des siècles et que l'Église y apporta son (gros) grain de sel en arrangeant les choses à sa manière (discutable) ne fait aucun doute.
Mais qui était donc Marie-Madeleine ?
Les confusions ne s'arrêtent pas là car, on le constate aisément à la lecture des livres saints, Jésus est entouré d'une
pléiade de "Marie". Il y a bien sûr la plus connue et la plus célèbre, la Vierge Marie, fille de Anne et de Joachim, qui enfanta de Jésus. Non moins célèbre
mais, on l'a vu aussi, effacée par deux millénaires d'opprobre, est Marie-Madeleine, la prétendue prostituée et néanmoins disciple de Jésus, Marie de Béthanie, Marie de Magdala, Marie, soeur de Lazare et de Marthe. Cependant, selon toute vraisemblance, les derniers personnages ne font qu'une seule et même personne. Disons tout d'abord que Marie-Madeleine ne s'est jamais appelée ainsi. Il s'agit seulement d'une francisation de Maria Magdalena et il est plus que
probable qu'elle se soit d'ailleurs appelée Myriam (ou Maryam) comme le veut la tradition juive. A noter que lors de la période trouble de son existence, l'abbé Saunière
(affaire Rennes-le-château) a voué un culte tout particulier à Marie-Madeleine, apparemment après avoir reçu une révélation, et lui a dédié une église, lui a érigé une tour
(la tour Magdala) et une propriété (la villa Béthanie). Marie Madeleine doit donc son nom à une tradition de l'époque qui voulait que l'on associait le prénom à la ville
d'origine, tout comme dans "Jésus de Nazareth". Un mot sur Magdala...
Magdala est identifié à Khirbet Medjdel (Migdal), à environ 6 km au N.-N.-O. de Tibériade, sur la mer
de Galilée. Situé près de la fourche formée par la route venant de Tibériade qui longe la mer de Galilée et celle descendant des collines de l'O., ce lieu occupait une position
stratégique. Les ruines d'une tour relativement récente qu'on y a découverte indiquent que Medjdel gardait autrefois l'entrée sud de la plaine de Gennésareth. Medjdel et
Magdala (forme de l'hébreu mighdal) signifient "Tour". Cet endroit est souvent considéré comme la patrie de Marie la Magdalène. Magadân pourrait être le même lieu que
Magdala, car des manuscrits plus récents mettent en Matthieu 15:39 "Magdala" à la place de "Magadân". On ne connaît aujourd'hui aucun endroit appelé Magadân dans les
environs de la mer de Galilée. Marc (8:10) appela le même territoire" Dalmanoutha". Peut-être que Dalmanoutha était simplement un autre nom de Magdala, à moins que ce ne
fût un endroit proche dont le nom, bien que peu utilisé ou peu connu, a néanmoins été préservé dans l'Évangile de Marc. Magdala était réputée pour ses conserveries de
poissons. Cette industrie était certainement pratique et rentable parce que la pêche dans cette partie du lac était abondante.
Nous conserverons comme hypothèse alternative de travail le nom de Meggido, pouvant lui-même provenir d'Armaggedon. Mais l'étude de cette possibilité nous mènerait trop
loin dans l'immédiat.

Le hiéros gamos
Nous en venons à l'une des explications quant à la confusion traditionnelle entre Marie-Madeleine et la " prostituée". Elle résiderait
dans la pratique du Hiéros gamos. Mais de quoi s'agit-il au juste ?
Hiéros gamos ou Hiérogamie, (du Grec hieros = saint et gamos = mariage, accouplement), fait référence à une union sacrée, à un
accouplement (parfois mariage) entre deux divinités ou entre un dieu et un homme ou une femme, généralement dans un cadre symbolique, souvent rituel.
Le psychanalyste Carl Gustav Jung le traite, parmi d'autres symboles fondamentaux universels de l'humanité, dans son ouvrage
"Métamorphoses de l'âme et ses symboles"
On peut le définir selon plusieurs points de vue :
La tradition véhicule une pléthore d'exemples tel Horus, fruit d'une union d'Isis et d'Osiris; ce rite hiérogamique, présent dans une foule de cultes antiques et repris dans le cérémonial de nombreuses sociétés secrètes, vise à remettre rituellement en scène ces phénomènes divins. Il existe
fondamentalement deux types de hiérogamies, de part leur finalité : la version païenne et la version mystique.
Dans l'optique païenne
Dans plusieurs traditions païennes et néo-païennes, où une analogie est établie entre la fertilité de la terre et la fécondité de la femme, la hiérogamie, le
plus souvent accomplie dans la nuit du 1er mai (célébration de Beltane dans le folklore celtique,
nuit de Walpurgis dans le folklore germanique), est un rite de fertilité, censé symboliser la plantation de
la graine dans la Terre et favoriser les pluies.
Dans l'optique mystique
Dans d'autres contextes, le Hieros Gamos revêt la forme d'un rite initiatique qui permettrait aux participants d'acquérir une expérience religieuse profonde par des rapports sexuels. Certains experts y voient une référence à la théorie néo-platonicienne selon laquelle une âme est originellement androgyne et se scinde en deux lors de l'incarnation sur terre, sa part féminine allant dans un corps de femme et sa part masculine dans un corps d'homme. Dans cette optique, la plénitude spirituelle ne serait retrouvable que dans la réunion des principes complémentaires («syzygie») qu'offre une hiérogamie. Dans le jargon jungien, on parle de la fusion symbolique de la femme et de son animus (principe masculin latent de chaque femme), ou de celle de l'homme et de son anima (principe féminin latent de chaque homme).
Exemples : En Mésopotamie, au printemps, le rite du mariage sacré unissait le Roi (remplaçant le dieu Dumuzi) et la prêtresse (représentante de la Déesse Ishtar). Les festivités étaient très joyeuses et se déroulaient dans l'allégresse. Un exemple moderne de hiérogamie se trouve dans la religion Wicca, dans laquelle les participants s'engagent dans ce que Gerald Gardner, fondateur du culte, appelait
le "Grand Rite". Un homme et une femme, assumant les identités du Dieu cornu et de la Déesse, s'engagent dans une union sexuelle pour
célébrer la conjonction sacrée des principes opposés/complémentaires masculin et féminin de l'Univers.
Il est donc très possible qu'avant de rencontrer le Christ, Marie-Madeleine ait pratiqué ce genre de rite initiatique en faisant référence
à d'antiques traditions ou en rapport avec le dieu-soleil, celui-ci étant à mettre en corrélation avec la fertilité de la terre, un culte qui trouve ses origines notamment
en Égypte. On comprend dès lors que les autorités religieuses du christianisme naissant aient voulu s'opposer à cette conception, leur nouvelle religion ne pouvait pas avoir
simplement été calquée sur une autre croyance, il fallait diaboliser l'acte charnel sans qu'il n'y ait de progéniture (et voilà qui a subsisté longtemps après) tout en
reléguant la femme au rôle d'esclave.
SOMMAIRE DU CDV - SOMMAIRE RELIGION(S) -
SOMMAIRE SURNATUREL - ACCUEIL
 |
